Le revers de la médaille : la santé mentale chez les grimpeurs pros

Depuis plusieurs années, toutes disciplines confondues, des voix s’élèvent. Des athlètes de haut-niveau comme Michael Phelps ou Naomi Osaka ont alerté l’opinion publique au sujet de la santé mentale. Autrefois taboue, cette problématique est aujourd’hui mieux prise en compte dans le sport. Mais l’est-elle aussi en escalade ? Et mesure-t-on bien son impact sur le risque de blessure ?
Loin d’être une simple question de bien-être, la santé mentale est intimement liée à la performance, à la résilience et, de manière critique, au risque de blessure. En cette année post-olympique, La Fabrique verticale s’est interrogée sur le revers de la médaille : quand la santé mentale fragilise le corps de l’athlète et impacte sa vie d’homme ou de femme.
Combien de grimpeurs se sont blessés à répétition dans la course à la qualification ? Combien n’ont pas pu décrocher leur ticket, soumis à une pression physique et mentale hors norme ? Enfin, combien ont décompensé après Tokyo 2020 ou Paris 2024 ? Sans préjuger du contexte dans lequel sont survenues toutes ces blessures, physiques ou narcissiques, plusieurs exemples viennent en tête et donnent à réfléchir.

Blessures : plus qu’un simple facteur psychique
Certains grimpeurs extrêmement talentueux, qui auraient pu briller aux Jeux, ont du faire leur deuil. Le cas du canadien Sean Mc Coll est assez parlant de ce point de vue. Qualifié aux Jeux de Tokyo en 2020, il a vécu une olympiade difficile jusqu’en 2024, marquée par des opérations de l’épaule. Et en définitive, il n’a jamais vraiment retrouvé son niveau avant blessure… On pense aussi à Manu Cornu qui a longtemps dû composer avec des douleurs au coude et a enchainé les blessures (entorse à la cheville droite, déchirure au biceps droit…). Autant de pépins physiques qui ont hypothéqué ses chances…
Affirmer de manière péremptoire que ces blessures sont en lien direct avec des problèmes de santé mentale serait évidemment caricatural. Et faux. Car comme l’a analysé le père de la sociologie française, Émile Durkheim, “toutes les fois qu’un phénomène social est directement expliqué par un phénomène psychique, on peut être assuré que l’explication est fausse” (Les Règles de la méthode sociologique, 1895).

Et bien évidemment, les causes de la blessure en sport sont multi-factorielles. Parfois une des causes peut être plus prégnante que les autres mais elle n’exclue pas la présence d’autres facteurs. En vrac : doute, déprime ou sensation de routine… Mais il est nécessaire aussi de prendre en compte la surcharge physique, la surcharge cognitive, la relation avec l’entraîneur ou avec les parents, la pression sociale, etc.
Sport de haut-niveau et santé mentale
Au-delà de la force physique et de la performance technique, il existe un facteur souvent négligé mais fondamental dans la carrière des sportifs de haut-niveau : la santé mentale. Or selon une étude réalisée du 25 mars au 12 avril 2024 par Harris Interactive auprès de 1 885 sportifs de haut-niveau âgés de 16 à 25 ans, 1 jeune sur 5 a reconnu rencontrer des difficultés. Certes, aucune étude n’a été menée à ce jour sur le public spécifique des grimpeurs professionnels. Mais il y a fort à parier qu’en creusant un peu, les résultats seraient similaires.
Cette enquête révèle également des risques de dépression modérée à sévère chez 17% de ces jeunes sportifs, des troubles anxieux généralisés (24%) et des troubles du sommeil (44%). Ces taux sont conformes à ceux de la population générale. Cependant, parce que les athlètes sont soumis à des pressions culturelles et environnementales importantes, ces troubles sont exacerbés.

La pression invisible : un fardeau constant
Les sportifs d’élite évoluent dans un environnement où la pression est omniprésente. C’est le cas aussi des grimpeurs. Attentes de performance, compétition acharnée, médiatisation intense, sacrifices personnels, gestion des échecs et des victoires – ces éléments créent un cocktail émotionnel complexe.
Cette pression constante peut entraîner des symptômes de dépression, d’anxiété, des troubles du sommeil et même des troubles alimentaires. Contrairement à une idée reçue, les sportifs de haut-niveau ne sont pas immunisés contre ces problèmes. Ils les vivent souvent avec une intensité accrue du fait de l’environnement unique dans lequel ils sont plongés.
Comme le raconte Oriane Bertone dans une interview accordée à Brut, “moi l’après Jeux, ça a été deux mois de dépression, enfermée chez moi, […] des émotions que je n’arrivais pas à canaliser. […] Les Jeux, ok c’était beau. C’était Paris 2024. Mais ça reste un des plus gros échecs que j’ai vécus”. Un échec qu’elle reconnaît ne pas avoir bien digéré. Même si dans la foulée, elle est montée sur la première marche du podium de la Coupe du Monde de bloc en 2025. Et sur la deuxième marche aux récents Championnats du Monde à Séoul.

Témoignages : quand la santé mentale se heurte à la performance
Solène Piret, grimpeuse professionnelle et membre de l’équipe de France de para-escalade, a exprimé elle aussi les difficultés d’ordre psychique qu’elle a traversées. C’est sorti dans un podcast, Outdoor Minds. Elle y raconte comment, bien que multi-médaillée, elle a vécu une période de mal-être profond qui l’a conduite à entreprendre une thérapie, devenue un pilier de son équilibre actuel.
Ces rares témoignages sont un peu l’arbre qui cache la forêt. En réalité, peu de grimpeurs s’expriment librement à ce sujet. Et d’ailleurs, lors de la préparation de cet article, nous avons pu noter à quel point cette question était taboue. Car hormis Manon Hily, Triple Championne de France d’escalade et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de difficulté en 2022 et aux Championnats du Monde en 2023, personne n’a donné suite à nos questions. Nous publierons plus tard son témoignage in extenso tant il est symptomatique de ce que peuvent vivre les athlètes silencieusement.

C’était intéressant en tout cas d’avoir son ressenti parce qu’elle s’est impliquée à 200% dans la préparation des Jeux. Mais elle n’a pas réussi à décrocher son ticket pour Paris 2024, en dépit d’un niveau exceptionnel. “Quand je suis entrée dans le process des qualifications olympiques, effectivement, j’ai senti vraiment que, mentalement, c’était beaucoup plus dur que d’habitude. Et j’ai ressenti le besoin d’aller voir une psy et d’avoir un préparateur mental”, reconnaît-elle.
Blessures physiques, douleurs mentales : un cercle vicieux
Cette approche l’a beaucoup aidée. Cela l’a protégée d’une tendance au toujours plus, fréquente chez les athlètes de haut-niveau et souvent synonyme de blessures. Un écueil qu’elle avait pu connaître par le passé. Comme elle le raconte, “à chaque fois, je me suis blessée quand j’étais au rupteur dans ma vie, que je bossais beaucoup, que je m’entrainais beaucoup… Et quand je commençais à être forte, j’en voulais encore plus”.
L’impact de la santé mentale sur le risque de blessure est une facette de plus en plus reconnue. Un athlète sous stress mental peut voir sa concentration diminuer, sa prise de décision altérée et sa coordination perturbée, augmentant ainsi sa vulnérabilité aux accidents. La fatigue mentale peut précéder la fatigue physique, menant à des mouvements moins précis et à une capacité de réaction réduite.
Réciproquement, une blessure physique a des répercussions psychologiques profondes. La frustration de l’inactivité, la peur de ne pas retrouver son niveau, l’isolement de l’équipe et l’incertitude quant à l’avenir… Autant d’éléments qui peuvent précipiter ou aggraver des problèmes de santé mentale existants. C’est vite un cercle vicieux. Car la mauvaise santé mentale augmente le risque de blessure. Et la blessure affecte négativement le bien-être mental. Tout ceci souligne l’interdépendance cruciale entre le corps et l’esprit.

Quel soutien pour ces athlètes en souffrance ?
Du reste, les troubles de santé mentale chez les athlètes sont non seulement associés à un risque accru de blessure, mais précédent également des résultats ultérieurs plus médiocres. C’est ce qu’ont montré conjointement des chercheurs de l’Université de Baltimore et de l’Université de Boston en 2024.
Malgré une prise de conscience grandissante, le soutien en santé mentale pour les athlètes de haut-niveau reste souvent insuffisant. Le stigmate associé aux problèmes de santé mentale persiste dans le monde du sport, où la force et la résilience sont souvent perçues comme l’absence de toute faiblesse. Les athlètes peuvent hésiter à exprimer leurs difficultés par peur d’être jugés, de perdre leur place ou de ne pas être compris.
De plus, les ressources spécialisées ne sont pas toujours disponibles ou facilement accessibles. Les équipes et les fédérations commencent à intégrer des psychologues du sport et des professionnels de la santé mentale. Mais le chemin est encore long pour que chaque athlète ait accès à un soutien adapté et confidentiel. La pandémie de COVID-19, avec ses annulations de compétitions et ses périodes d’incertitude, a d’ailleurs mis en lumière de manière criante ces lacunes.

Santé mentale : vers une approche holistique
Reconnaître et prendre en compte la santé mentale des sportifs de haut-niveau n’est pas seulement une question d’humanité. C’est aussi un impératif pour la performance durable et la prévention des blessures. Les initiatives visant à dépister, soutenir et intervenir précocement sont essentielles. Cela inclut l’éducation des entraîneurs et du personnel d’encadrement, la création d’espaces de parole sécurisés… Et l’intégration systématique de professionnels de la santé mentale dans les structures sportives.
En fin de compte, la santé mentale n’est pas un accessoire, mais un pilier fondamental de l’athlète complet. Investir dans le bien-être psychologique des sportifs de haut-niveau, c’est investir dans leur longévité, leur succès… Et, surtout, dans leur qualité de vie.
Bibliographie
How Mental Health Affects Injury Risk and Outcomes in Athletes, Davis L Rogers, Miho J Tanaka, Andrew J Cosgarea, Richard D Ginsburg, Geoffrey M Dreher, Sports Health. 2024 Mar-Apr;16(2):222-229. doi: 10.1177/19417381231179678. Epub 2023 Jun 16. Résumé ici.
Photos (c) IFSC et AFP
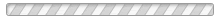





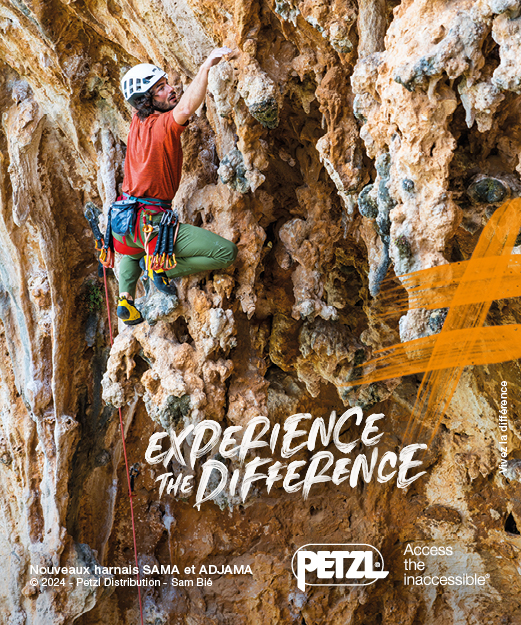


Bonjour Laurence,
Tu fais bien de citer Émile car il dit tout : laisser la question de santé mentale aux psychologues et autres préparateurs du « mental » est une erreur. Cela participe d’une « psychologisation du social dans le sens de son occultation ». Tout se passe comme si nous avions à faire une « episteme individualisante ». Elle est à l’œuvre dans la manière de penser le chômage comme l’on montré Crespo et Serrano sur la doctrine de l’UE sur le chômage : si le chômeur ne trouve pas de travail, ce n’est pas parce qu’il n’y en a plus mais parce que cela relève d’une pathologie de la volonté. De même la personne en burn out ou le pervers narcissique sont des individus déviants mais pas des gens qu’une organisation humaine a laissés sombrer ou s’accomplir dans leurs penchants délétères pour eux ou pour les autres. De même, le dopage est pensé comme une contravention individuelle à la morale et aux règlements sportifs et non comme la réponse maladroite à des conditions de travail et d’emploi insoutenable. Chez les coureurs cyclistes, une vague de discours analogue sur le mal-être au travail existe depuis maintenant cinq ans. Mots nouveaux sur maux anciens ou nouvelle tendance ? En tout cas pour les coureurs, l’analyse des équipes montre clairement qu’une organisation peut par ses disfonctionnements dans l’encadrement des athlètes engendrer un mal être au travail (travail car c’est ce dont il est question). Tout cela est très bien étudié dans le monde du travail non sportif par les sociologues notamment dans le cadre des expertises commandées légalement par les CSE. Pourquoi ne faudrait-il pas regarder les athlètes de la même manière ? La chose pour l’escalade est cependant assez particulière, comme en tennis, au golf (là aussi il y a des travaux sur la précarité au travail qui intègrent la question de la mesure de la valeur, de la reconnaissance accordée par le collectif), il ne va pas de soi qu’un athlète ne puisse bien fonctionner que si son écosystème fonctionne bien…Pourtant même dans les sports d’apparence individuelle tout se joue dans le collectif Le mieux plutôt que de s’en remettre aux psychologues serait de voir d’abord qui entoure les grimpeurs pro et comment…