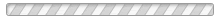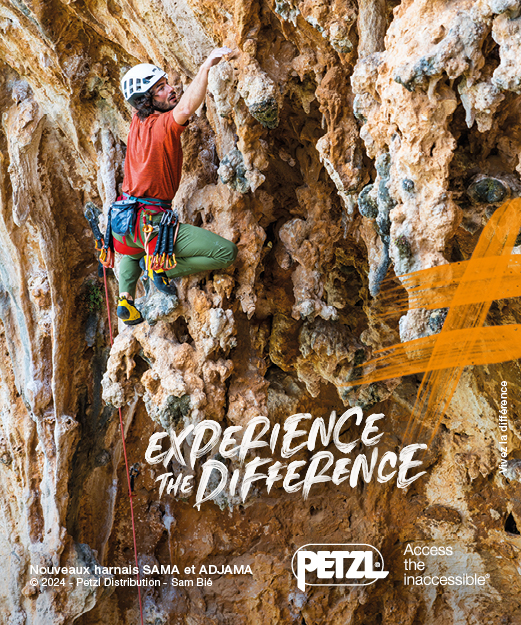De la falaise au plastique et vice versa : la connexion inattendue

Falaise : quelle place doit prendre la pratique outdoor dans le projet sportif d’un compétiteur ? Comment articuler harmonieusement performances en extérieur et objectifs en compétition ? Faut-il forcément bannir toute séance en extérieur de sa préparation avant un événement ? Pour répondre à ces questions, La Fabrique Verticale a interrogé des entraineurs qui officient au sein des Équipes de France d’escalade à la FFME. Tour d’horizon des différents points de vue.
Si certains athlètes et entraineurs jugent la falaise trop éloignée des exigences spécifiques de la compétition, d’autres au contraire y voient une opportunité pour enrichir leur expérience. Alors la falaise peut-elle être l’invité surprise dans la préparation des compétiteurs de difficulté ? Une question qui suscite le débat, y compris au sein de la communauté des entraineurs. Car l’escalade en outdoor peut jouer un rôle complémentaire et stimulant dans l’entraînement d’un compétiteur qui évolue sur le circuit international, en particulier chez les jeunes.
C’est d’ailleurs ce que souligne Vincent Etchar, entraineur de Manon Hily et Ina Plassoux-Djiga en seniors, mais aussi de ses enfants, Tolani et Akyan (médaille d’argent aux Championnats d’Europe jeunes en U19). Pour lui, cette dimension est “primordiale dans la formation et apporte une vraie plus value”. En particulier sur le plan du bagage gestuel mais aussi de l’adaptabilité et des capacités de réorganisation.

Falaise ou pas falaise : le grand débat
Nicolas Januel, l’entraineur qui a accompagné Oriane Bertone dans sa préparation pour le combiné aux JO de Paris 2024, l’exprime très bien. “En difficulté, l’effort reste à 90% de la performance jouant sur de l’énergétique. Certes les prises ont évolué, la gestuelle aussi évidemment… Mais on reste sur un effort très typé résistance. La précision gestuelle, la capacité de grimper à l’économie et à maintenir une qualité gestuelle en dépit de la fatigue, autant de qualités qui sont primordiales pour performer en compétition et que la pratique de la falaise peut aider à développer”.
Romain Desgranges, ex-compétiteur de très haut niveau (Vainqueur de la Coupe du Monde en 2017 et double champion d’Europe en 2013 et 2017), a un avis plus tranché. Aujourd’hui entraineur en diff’ à la Fédération, il plaide en faveur d’une approche ultra-spécifique. Et beaucoup plus radicale ! “C’est un sujet à la fois vaste et complexe. Le mur et la falaise représentent deux versions différentes du sport. Mais que peut apprendre Léon Marchand en nageant dans la mer ?”

“Techniquement, physiquement, mentalement, on évolue dans des domaines très différents, résume-t-il. Tout dépend donc de la période de développement et du projet du grimpeur. Tu peux, ponctuellement, aller chercher en extérieur des points précis selon tes besoins. Le piège, c’est que la falaise, c’est “facile” : tu y vas quand tu veux, tu perfs quand tu peux. La compétition, en revanche, c’est le jour J, à l’instant T.” CQFD.
Intérêts dans la formation des jeunes grimpeurs
Du côté des points positifs, on pourra arguer que l’adaptation à des profils variés et à différents types de rocher sollicite la créativité et la capacité à improviser dans l’action. Car chaque voie est différente et demande d’analyser en temps réel la meilleure séquence gestuelle. L’exposition à des mouvements retors ou des facteurs imprévus accroît la gestion du stress, qualité clé dans la préparation mentale pour les compétitions. Et avoir une expérience de falaisiste ne nuit jamais. Cf Jakob Schubert ou Adam Ondra, qui ont toujours su mener les deux de front.
Tanguy Topin, longtemps entraîneur au Pôle Espoir escalade à Voiron et aujourd’hui en charge de l’Équipe jeunes à la Fédé avec Baptiste Dherbily, abonde en ce sens. Et cite ainsi l’exemple de Camille Pouget qui à la base ne vient pas de la falaise. “Elle commence à y aller plus régulièrement. Et elle sent que ça lui fait du bien. Elle vient rajouter un ingrédient en plus à son escalade, dans la grimpe en 3D et les mouvements inconfortables et tordus.”

Donc, à première vue, faire pratiquer l’escalade en milieu naturel à des jeunes espoirs semble être une approche intéressante. Puisqu’elle permet de développer des compétences essentielles qui pourront être réutilisées par la suite lors des compétitions, quand ils arriveront à maturité. Pour autant, elle comporte aussi certaines limites propres à son contexte. Ainsi, pour de nombreux entraineurs, la question mérite d’être posée. Et la balance penche souvent du côté d’une préparation uniquement indoor…
Les limites liées à la spécificité et points de vigilance
Comme le raconte Tanguy Topin ,“[avec Baptiste Dherbily], on est tous les deux d’anciens compétiteurs, maintenant mordus de caillou. Donc notre sensibilité pour la falaise est plus forte que chez certains entraîneurs à la Fédération, c’est sûr ! Mais nous ne sommes pas les seuls. Je pense à Esteban [Daligault] et Mike Fuselier sur le Pôle France qui sont d’excellents falaisistes. [Pour autant] on est tous conscient que le fait de faire de la falaise n’est malheureusement pas aussi bénéfique qu’on aimerait le penser…”.

La falaise comporte des contraintes logistiques (transport, météo, accessibilité des sites) qui limitent la régularité de pratique et la structuration de l’entraînement. Et la salle permet justement ce suivi régulier et quantifiable, indispensable pour optimiser la performance. De plus, l’outdoor n’offre pas la standardisation des voies, ni la possibilité de répéter systématiquement des mouvements pour travailler des qualités spécifiques (puissance, explosivité, coordination). C’est sa plus grande limite…
Et de citer en exemple le cas de Pierre Marzullo, novogradiste et falaisiste depuis son plus jeune âge. NDLR : il a réalisé Supercrackinette, 9a+, à St Léger, à l’âge de 16 ans. “Lorsqu’il va dehors pour un projet, explique Tanguy Topin, ça lui demande à chaque fois une grosse réadaptation à l’intensité quand il revient à l’entraînement sur le plastique. Actuellement, il vient de décider de faire une croix pendant un moment sur la falaise « jusqu’à ce qu’il fasse un podium de Coupe du Monde ».” Un choix clair et assumé !

Trouver le bon dosage entre plastique et falaise
À La Fabrique verticale, nous avons eu l’occasion de croiser Mattéo Soulé en falaise l’été dernier en Suisse, peu de temps avant son podium aux Championnats d’Europe jeunes. Au cours de cette période, il a réalisé une belle série de croix (jusqu’à 9a après travail et 8b+ flash). Mais ça ne l’a pas empêché de glaner une médaille d’argent en U21 à Žilina en Slovaquie, 15 jours plus tard. Démontrant ainsi que la préparation en falaise n’est pas incompatible avec les performances en compétition….
Fin de la discussion ? Difficile à dire… Car peut-être aurait-il décroché l’or s’il avait tout misé sur un travail ultra spécifique et 100% en salle ? Ou au contraire, n’aurait-il rien fait, la falaise lui apportant un surcroît de plaisir et de motivation, indispensable à son équilibre ! Tout ceci montre bien qu’il n’y a pas de réponse unique. Tout est question de dosage. Quoiqu’il en soit, l’ensemble des entraineurs que nous avons interrogé se rejoignent sur un point, la notion de complémentarité. Et surtout sur le choix des voies et de la période !

Pour Nicolas Januel, falaise et indoor sont “complémentaires à condition de bien choisir les périodes et le type de voies essayées. Les très forts grimpeurs, en particulier les hommes, vont beaucoup dehors et finalement ils ne vont pas forcément que dans des voies qui sont très typées compète. Quand ils vont à Flatanger faire des voies de 70 m où ils restent très longtemps dans la voie… Mais par contre, ils font quand même ça en décalé de la saison. Et ça leur permet de travailler sur d’autres qualités.”
Le choix de la période et du type de voies
On le voit bien, il s’agit surtout de trouver les bonnes périodes et de cibler les bonnes voies. C’est-à-dire assez proches en termes d’effort de l’intensité des voies sur mur. L’intérêt d’intégrer de la falaise se ressent surtout pour la précision gestuelle et l’exigence en résistance, en particulier si les voies essayées dehors sont des projets après travail très durs, qui permettent d’aller explorer des enchainements beaucoup plus difficiles que ce qui est proposé indoor, en compétition.
Un point sur lequel Nicolas Januel insiste. Mais il s’agit “aussi de brasser des types de voies différents”. C’est-à-dire “ne pas aller s’enliser dans un projet pendant deux ans qui n’est pas du tout typé compète au niveau énergétique”. Tout en soulignant qu’à certains moments de la saison, il peut être intéressant d’aller dans des projets complémentaires, qui peuvent avoir des vertus par rapport à l’entrainement habituel. Car il y a alors plus de challenge. Et ça permet de diversifier la préparation en termes de stimulations.

Même constat pour Tanguy Topin, qui garde aussi en tête la question de l’accompagnement, notamment avec les plus jeunes. “Physiquement on est sur quelque chose d’extrêmement différent. [Donc] je ne vois pas vraiment de sens sur le plan physio / énergétique. Sauf pour les qualités de force doigts. Par contre, si l’idée c’est d’utiliser le support stratégiquement avec un connaisseur qui va être capable de guider un jeune sur un style de falaise en particulier, pour provoquer une adaptation grâce au changement de terrain de jeu (relâchement, engagement sur des petits pieds, etc…), là ça peut avoir du sens.”
Le pourquoi du comment : que va-t-on chercher en falaise ?
Aller ou non en falaise ? That is the question ! Tanguy Topin “n’y [est] pas opposé. Mais [il] pense que ça doit être bien réfléchi. Qu’est ce que l’on va y chercher ? Pour [lui], c’est la question à se poser. Et les réponses sont nombreuses. Car la base [de l’entrainement], ça reste pour [lui] la spécificité de la salle”. Adaptabilité, technique, haute qualité gestuelle, précision, économie… Les raisons d’aller se frotter à des projets durs en extérieur en vue de progresser en compétition ne manquent pas.
De plus, le choix d’aller dehors peut aussi permettre de se professionnaliser plus facilement et de valoriser ses résultats auprès des sponsors qui recherchent des profils d’athlètes polyvalents. Une tendance que relève Tanguy Topin. “C’est vrai qu’on voit de plus en plus de monde aller faire un trip en falaise, en bloc… Certains, comme Jules Marchaland par exemple, arrêtent [même complètement] la compétition pour se consacrer à la falaise ou au bloc extérieur. Car ça leur plaît et que ça rapporte bien plus de partenariats”.

Et bien évidemment, le background de l’athlète (âge, vécu, expérience en falaise, début ou fin de carrière) joue un rôle. Ainsi que la motivation. Car le fait d’aller dehors permet de se ressourcer, de prendre une bouffée d’oxygène après ou pendant la saison. C’est aussi un moyen de concrétiser sur un autre support. Et de faire ses preuves dans une autre dimension de l’activité.
Quid du bloc ?
Finalement, aller en falaise pour un compétiteur de diff’ peut donc être une stratégie payante. En tout cas, pas si déconnante… À condition de le gérer intelligemment. Car en terme d’entrainement, ça permet de pousser le curseur plus loin en terme d’intensité, dans des voies après travail extrêmes plus dures que des voies à vue max essayées sur mur. Et il faut alors grimper juste, en dépit de la fatigue.
En bloc, “c’est plus dur à transférer”, explique Nicolas Januel. Du fait des préhensions (macros volumes, etc) et des coordinations à explorer. Donc l’extérieur sera toujours plus à la marge dans le projet sportif d’un bloqueur que d’un compétiteur de diff’. Mais il faut quand même en tenir compte dans la dynamique de motivation d’un grimpeur”. Ce qu’il fait avec Mejdi Schalck.

Par contre, “je te rejoins totalement sur tout ce qui est travail technique en falaise, dans le cas d’un compétiteur de diff’. Je pense que c’est formateur d’un certain côté. D’un autre côté, notamment en bloc, il y a quand même des techniques spécifiques. Surtout maintenant avec les nouvelles prises, les dual textures, les macros, et tout. Et ça, c’est quand même un travail technique qui est ultra spécifique à l’indoor”.