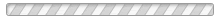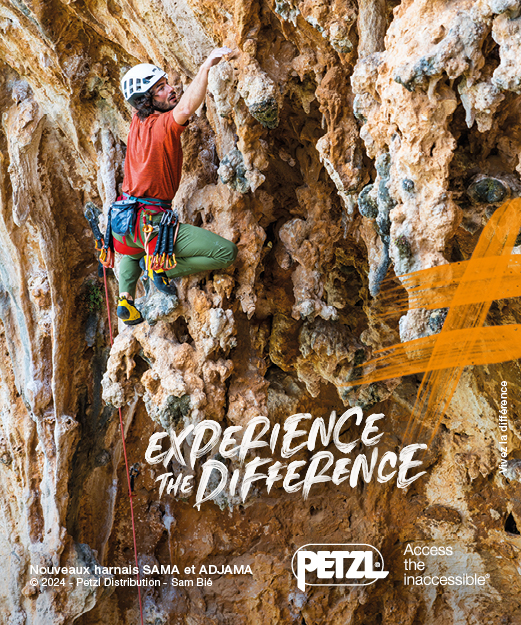La Récupération en Escalade : L’Élément Invisible qui Fait la Différence

De quoi dépend le succès de notre entraînement ? D’exercices bien ciblés. De séances bien adaptées à nos objectifs et nos besoins. D’une organisation logique au fil des jours et des semaines…
Si, grâce aux réseaux sociaux notamment, les sources d’inspiration pour trouver des exercices sont nombreuses, il y manque cependant toujours un paramètre fondamental. Et c’est normal car il est en quelque sorte « en creux », par définition peu instagramable ! Ce paramètre si essentiel et si peu visible, c’est celui représenté par les intervalles entre les exercices, entre les séances, consacrés ni plus ni moins à la récupération et au repos…
La focalisation sur les exercices eux-mêmes est telle que nous avons souvent, en tant que coachs, de grandes difficultés à faire en sorte que certains des grimpeurs que nous entraînons respectent suffisamment ces « temps creux ». Leur position est compréhensible : Ils pensent que plus on leur proposera de stimuli d’entraînement, plus ils progresseront. Ils ont – en partie – raison.
Mais ce faisant, ils négligent les bienfaits qu’ils retirent de ces moments de repos durant lesquels il ne se passe pourtant pas… rien ! Car les récupérations sont le siège de différents processus, physiologiques mais aussi mentaux qui vont permettre lors de la répétition ou l’exercice suivant, lors de la prochaine séance, de produire des efforts à la « bonne » intensité, celle qui permettra de progresser encore et encore. En d’autres termes, les récupérations permettent à l’organisme de s’adapter, pour répondre à de nouvelles sollicitations. Sur le temps long, la succession harmonieuse de stimuli et de repos permet à noter corps d’évoluer pour répondre de plus en plus efficacement.
Pourquoi se reposer est obligatoire ?
Pour retrouver nos capacités physiques
Lors des entraînements physiques ou des séances d’escalade, les qualités physiques comme la force (doigts, bras, épaules…), la puissance, l’endurance de force locale sont sollicitées, avec comme symptôme la fatigue. Qui est qualifiée de centrale quand elle affecte les grands systèmes (système nerveux, système cardiaque…) ou de périphérique quand elle concerne les capacités musculaires elles-mêmes. Les phases de récupération, lors des séances elles-mêmes et entre les séances (on parlera alors plus volontiers de repos), sont mises à profit pour restaurer partiellement ou complètement ces capacités. Chacune a cependant son propre rythme et ses particularités.
Si par exemple vous essayez un bloc à votre limite absolue, ou que vous faites des suspensions ou tractions maximales vous avez besoin d’au minimum 3 minutes (mais cela peut aller jusqu’à 10 minutes !), pour que votre système nerveux soit à nouveau capable de faire générer des tensions maximales à vos muscles. Et pour que ces derniers reconstituent leurs réserves énergétiques.

Si vous faites des runs dans votre projet, une bonne base de résistance de 40 mouvs, votre capacité à refaire un essai significatif peut nécessiter jusqu’à 1 heure de récupération, histoire d’éliminer les ions H+ que vos muscles des avant-bras ont accumulés, et de reconstituer vos stocks musculaires de glycogène !
Pour récupérer notre agilité
Mine de rien, et en particulier en bloc, l’escalade requiert une grande précision gestuelle et elle met en jeu des coordinations qui peuvent être très complexes à exécuter.
Lorsque celles-ci sont mises en jeu au cours d’un effort par ailleurs extrêmement intense, et bien on constate qu’elles sont aussi impactées. Ainsi la fatigue affecte les processus de contrôle moteur, la précision motrice et le niveau d’excitabilité neuro-musculaire : pas évident alors de bien envoyer des skates ou des électro 😉
Pour récupérer mentalement
S’entraîner affecte aussi nos capacités cognitives et impacte les paramètres psychologiques. Mais la relation entre récupération et mental est complexe et porteuse d’implications contradictoires.
Un grimpeur (ou un athlète en général) qui ne récupère pas bien – ou pas assez – a plus de difficultés à réguler son stress (ça peut être désastreux pour les compétitrices ou compétiteurs). Il a aussi de fortes chances de subir à terme des baisses de motivation.
Nonobstant, comme la confiance en soi se construit aussi par l’enchaînement des séances d’entraînement, beaucoup craignent ces jours où il ne faudrait « rien » faire. Car alors, un sentiment de perte de contrôle peut survenir. Récupérer devient alors, de façon apparemment paradoxale, source d’anxiété. C’est en ajustant les modalités de récupération que l’on peut trouver le juste équilibre.
Les composantes et modalités de récupération
De la même façon qu’il va caler l’intensité des exercices lors d’une séance, leur quantité, leur ordre, l’entraîneur doit finement régler les différents temps de récupération, en tenant compte de facteurs physiologiques mais aussi des conditions et de « l’état du jour ».
Récupération passive vs. récupération active
L’entraînement de la force maximale requiert ainsi des récupérations passives, qui permettent la reconstitution des ressources énergétiques. C’est le cas aussi pour des séances de résistance « courte » où l’objectif est d’améliorer la capacité musculaire à fournir de l’énergie à des intensités proches du maximum.
S’il s’agit par contre de rendre nos muscles capables de fournir encore de l’énergie, alors même que l’acidité les envahit déjà, c’est-à-dire augmenter leur capacité à tamponner cette acidité, alors des récupérations légèrement actives peuvent être appropriées.

Récupération complète vs. récupération incomplète
On parle de récupération incomplète lorsque le temps disponible entre deux efforts ne permet pas de restaurer complètement nos capacités.
Typiquement, lorsqu’on fait des boucles de résistance en série sur le pan ou la Kilter, on peut utiliser ce type de récupération afin de conduire peu à peu à une accumulation de fatigue et simuler ce qui se passe dans une voie, après plusieurs minutes d’effort. C’est donc super intéressant pour améliorer notre capacité à enchaîner des efforts très intenses et à résister à la fatigue. Pensez-y avant votre prochain contest de bloc !!
La limite dans l’utilisation de récupérations incomplètes réside dans le risque qu’il y a à générer aussi une fatigue centrale. Une solution consiste alors à introduire des phases de récupération complète dans les séances. Plutôt que de faire 12 boucles de rési avec récupérations incomplètes, on fera 3 blocs de 4 boucles en séparant les blocs par des récupérations complètes.
Les indicateurs d’une « bonne » récupération
Alors qu’est-ce qu’une « bonne » récupération ? A l’échelle d’une séance d’entraînement on peut dire que c’est celle qui va nous permettre de réitérer des efforts à l’intensité qui est requise par le type d’exercice. Par exemple, être capable de produire 5 à 10 efforts à 100 % de notre force maximale.
Pour ce qui est du repos entre les séances, c’est celui qui donne juste le temps qu’il faut à l’organisme pour effectuer des adaptations cellulaires ou métaboliques, afin de pouvoir ensuite répondre à des sollicitations qui seront encore plus fortes.
Sur un temps plus long, un entraînement comportant suffisamment de récupération conduit à une progression. Alors que l’accumulation d’un manque de récupération conduit inévitablement à la stagnation, puis à la régression et la blessure : c’est le surentraînement.

Les indicateurs de récupération objectifs et leurs limites
Pour évaluer la fatigue et la récupération, on dispose de deux types d’indicateurs.
Indicateurs objectifs
On peut tout d’abord mesurer l’évolution des performances elles-mêmes : Au bout de combien de temps je peux refaire ce bloc max ou tenir la même durée pour cette suspension à 2 mains sur 20 mm ?
On peut mobiliser des indices biologiques. Évolution de paramètres endocriniens (rapport testostérone / cortisol, IGF-1…). Évolution de facteurs enzymatiques, comme la créatine kinase, d’indicateurs de l’inflammation musculaire (protéine c réactive)… Sans oublier les classiques indicateurs physiologiques comme la lactatémie, la fréquence cardiaque… Recueillir ce type d’indices a cependant un coût et n’est pas accessible à tout un chacun.
Indicateurs subjectifs
Parallèlement à la mesure de variables objectives, il est possible de mobiliser des indicateurs subjectifs. C’est plus facile à réaliser, peu coûteux. Reste à savoir si cela présente un intérêt. C’est à cette question qu’ont tenté de répondre Anna Saw, Luana Main et Paul Gastin dans une revue systématique publiée en 2015 dans le British Journal of Sport Medicine.
Ce qui ressort de cette revue de littérature est très intéressant. Les auteurs montrent en effet la pertinence des mesures subjectives pour la surveillance régulière des athlètes.
Ainsi, l’évaluation par les athlètes eux-mêmes des troubles de l’humeur, du stress général, émotionnel ou des symptômes du stress, du bien-être, de la qualité du sommeil apporte des informations souvent plus fines, consistantes que celles apportées par les mesures objectives. Elles permettent surtout de détecter plus précocement des signes de surentraînement.
Il n’est donc pas question d’abandonner toute mesure objective : Une inflammation récurrente, une infection ou une carence alimentaire ne peuvent se détecter que par des mesures de laboratoire. Mais la validation des indicateurs subjectifs ouvre bien la porte à une utilisation plus systématique chez tous les sportifs

Construire une connaissance de soi
Il ressort de tout ceci que pour guider finement tout entraînement, l’usage de données objectives, de métriques, derrière lesquelles certains coachs ont tendance à systématiquement se réfugier (c’est plus rassurant), ne suffit pas. La prise en compte d’informations plus discrètes, comme des changements d’états psychologiques ou relationnels se révèle tout aussi primordiale.
À titre individuel, cela implique donc de se donner le temps, quotidiennement, de réaliser ce type d’évaluation. Avec nos grimpeurs, nous utilisons par exemple le test de Hooper. Grâce à quelques questions très simples, celui-ci fournit un indice dont l’évolution jour après jour renseigne sur le bien-être.
Une façon pour nous de détecter plus rapidement toute évolution indésirable. Une manière pour chacun de mieux se connaître et intervenir sur son propre entraînement.

Références
Saw A.E., Main L.C., Gastin P.B. (2016) : Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. British J of Sport Medicine 50(5), 281-91. PMID: 26423706
PMCID: PMC4789708
DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758
Charest J., Grandner M.A. (2022) : Sleep and Athletic Performance: Impacts on Physical Performance, Mental Performance, Injury Risk and Recovery, and Mental Health: An Update. Sleep Medicine Clinics 17-2, 263-282. https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2022.03.006